Manger en conscience… ou se conformer ?
Cela fait des années que le concept de « manger en conscience » est promu dans le champ du développement personnel, de la nutrition, de la thérapie, dans les magasines féminins, et les posts des réseaux sociaux.
L’intention semble logique et noble : nous inviter à prêter attention à ce que nous faisons, à ralentir, à ressentir.
Mais cette invitation devient souvent problématique lorsqu’elle se transforme en injonction. Car manger en conscience, ce n’est pas simplement mastiquer lentement, respirer profondément et remercier ce qu’on avale. C’est aussi — et peut-être surtout — pouvoir ressentir ce que l’on mange. Car tout notre système des sens est là pour cela, analyse des odeurs, des gouts, des saveurs, nos papilles et notre odorat sont d’une sensibilité et d’une complexité incroyable.
Donc ok, si manger « en conscience » génère du plaisir, mais cela inclut également la possibilité de dire :
« non merci, je ne continue pas»
« Ce que je mange ne me plaît pas »
« Je n’ai pas envie. »
« Ça me dégoûte. »

C’est ressentir pleinement ce que l’on s’apprête à avaler.
Parfois, manger vite est une manière très efficace d’éviter le dégoût.
Qui ne l’a pas déjà expérimenté ? 😉
Manger en conscience, c’est avoir la pleine liberté intérieure de reconnaître que ce qu’on mange n’est pas bon (pas à notre goût), et ne nous plait pas.
Et que ce ressenti puisse être accueilli à l’extérieur, sans qu’on te renvoie une injonction morale.
Parce que si « manger en conscience » devient :
alors ce n’est plus de la conscience. C’est de la soumission.
Il est temps de questionner toute la chaîne :
Les choix faits au Parlement sur les aliments « de base » (pain, eau, additifs, arômes…)
La difficulté pour les cuisiniers à défendre leur art dans un secteur sans réglementation
La précarité des maraîchers et des producteurs non intensifs
l’industrie qui a remplacé les cuisiniers dans les organismes collectifs, sans aucune attention pour les qualités organoleptiques
Et cette vague post-new age qui saupoudre tout de pleine conscience… jusqu’à l’aliénation.
La conscience commence là où la vérité peut être dite sans punition.
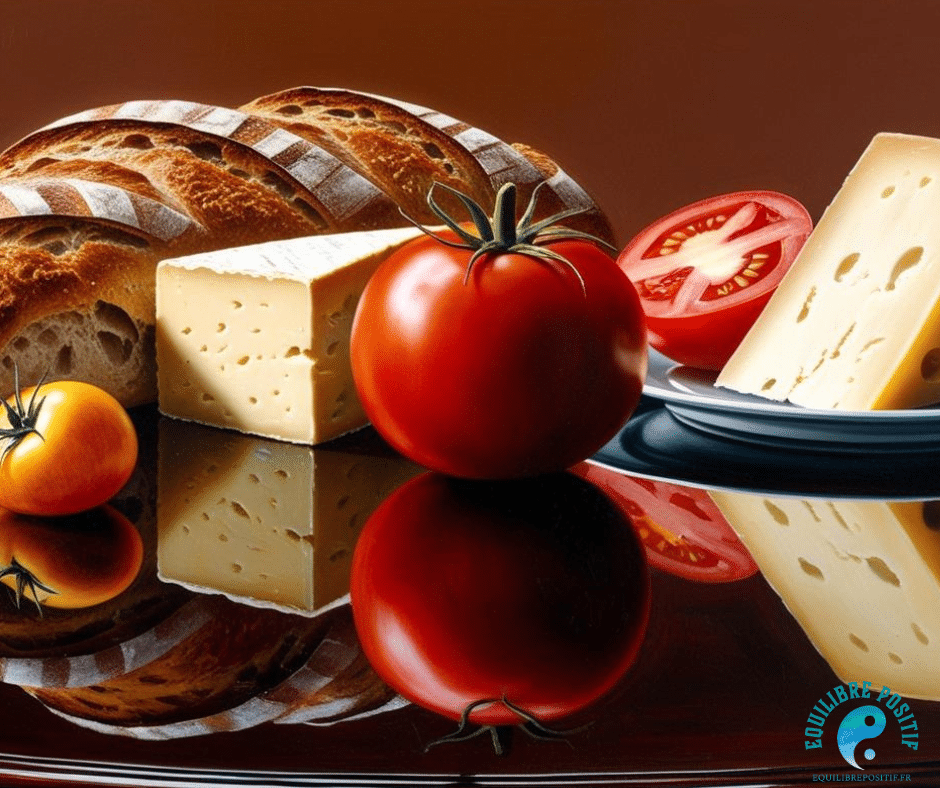
Or, force est de constater, qu’il est de moins en moins possible d’exprimer ce genre de ressenti sans se heurter à une forme de culpabilisation, voire de disqualification.
Comme si le simple fait de dire « je n’en veux pas, je n’aime pas ça » devenait désormais un manque de conscience, une faute morale.
Mais alors, de quelle conscience parle-t-on ?
Si l’on ne peut pas nommer ce qu’on ressent, s’il n’est pas permis de dire non, alors il ne s’agit plus de conscience. Il s’agit d’adhésion forcée, de soumission à une norme déguisée en bienveillance.
Ce glissement est d’autant plus pernicieux qu’il agit sur un terrain sensible : l’alimentation.
Un terrain chargé de mémoire, de partage, d’affection, de culture, de survie… et de contrôle social.
C’est dans ce contexte qu’il devient urgent de poser une question simple :
peut-on dire simplement ne pas aimer ce qu’on mange ?
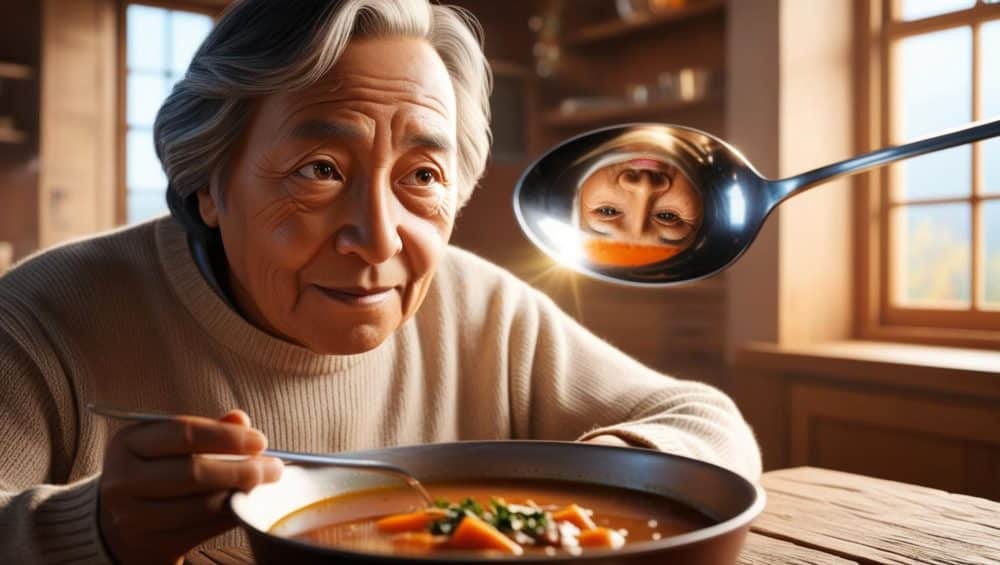
Et si ce droit n’existe plus, alors tout le discours sur la conscience alimentaire devient un écran de fumée, un outil de dressage recouvert d’un vernis spirituel ou thérapeutique.
La vraie conscience commence là où la vérité peut être dite sans punition.
Sans culpabilité imposée.
Sans qu’on soit sommé de sourire à ce qu’on rejette.
Quand manger « en conscience » revient à taire son ressenti, il ne s’agit plus de conscience.
Il s’agit de contrôle.
Et tout comme on dresse un chien en lui donnant à manger ce qu’on a décidé pour lui, on peut aussi dresser un être humain à s’auto-surveiller en l’enveloppant d’un discours positif.
Alors la question qui me taraude en ce moment, alors que les farines d’insectes sont déjà intégrées, que j’ai gouté des grillons grillés au curry à l’apéro, et le Mercosur vient d’être « enfin » signé, (1994b- date de la première pétition a laquelle j’ai participé concernant l’opposition au traité du Mercosur).
Bref, dans notre beau pays de la gastronomie, la question n’est donc pas seulement : que mangeons-nous ?
Mais : avons-nous encore le droit de dire ce que nous en pensons autour d’une table ?
